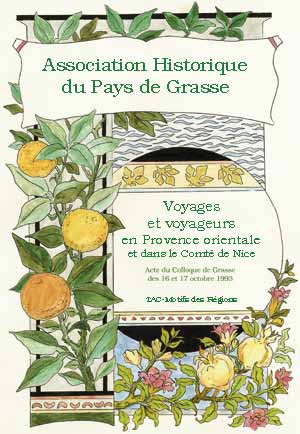
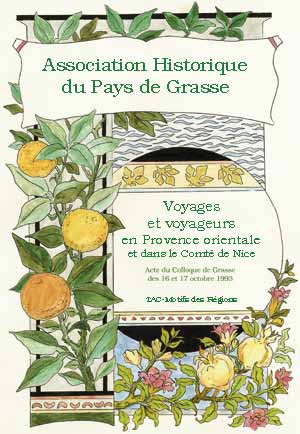
Voyages et voyageurs
Préface
Publier et étudier les récits de voyage en Provence, ce n’est
pas une idée neuve, puisque dès le début de ce siècle,
en 1904-1905, l’Académie de Marseille présentait dans ses
Mémoires le Journal manuscrit d’un voyage de Dijon en Provence
par M. Fleutelot en l’année 1719 ; en 1986, la revue Provence
Historique sous la signature d’ Y. Paret nous a donné un exposé
sur les voyageurs en Provence à la fin de l’Ancien Régime:
Images de la Provence à travers les récits de voyage (1760-1790),
extrait d’une thèse sous le même titre mais aux limites
chronologiques plus larges : Du XVIIe au XIXe siècle, thèse
soutenue à Aix en juin 1984. Il y faut ajouter un récit anonyme
conservé sur les dernières pages du registre de Fleutelot et
publié sous le titre : Un voyage d’agrément dans le sud-est
de la France pendant la Révolution par la Revue vauclusienne, organe
du département d’histoire et de géographie de la Faculté
des Lettres et Sciences humaines d’Avignon.
Les nombreux récits de voyage analysés par les organismes de
recherche méridionaux, font apparaître le souci qu’ont les
Provençaux de bien dessiner la personnalité de la région
à laquelle ils sont attachés ; cette préoccupation relève
du besoin caractéristique de notre époque : définir son
identité ethno-culturelle. C’est ainsi, qu’en 1992 encore,
ont été édités par l’Université de
Provence, les actes d’un colloque organisé au printemps précédent
par le Centre Méridional d’Histoire, animé par le Professeur
Bernard Cousin. Cette assemblée a consacré ses travaux au document
historique qu’est l’image ; le recueil a pour titre : Images de
la Provence, Les représentations iconographiques de la fin du Moyen
Age au milieu du XXe siècle (Université de Provence, Publications,
Aix 336 pp). Dans le même état d’esprit, le département
d’histoire de l’Université de Nice a placé au premier
rang de ses recherches, les définitions de l’identité niçoise
et offert dans le numéro 43 des Cahiers de la Méditerranée
(décembre 1991) le recueil des actes d’un colloque sur ce sujet
; plus près encore de notre approche, un chercheur de ce département,
Marie-Lucie Véran, attaché territorial à la municipalité
de Cannes, a présenté un ouvrage : Le réel et le pittoresque
dans le paysage cannois au XIXe siècle, (256 pp polygraphiées
et fort bien illustrées).
Quant à nous, ce n’est pas l’idée que se font les
Provençaux de leur patrie que nous allons examiner, mais à l’exception
de Peiresc en contrepoint, l’image, la représentation que leur
renvoient les récits de voyages en Provence rédigés par
des ressortissants à d’autres provinces, ou les dessins, aquarelles
et tableaux qu’ils en ont tirés. Peut-être l’originalité
de notre colloque est là: ces récits de circuits d’agrément
sont en partie des « géographies imaginaires »
comme dirait Pierre Jourde : la réalité perçue reste
bien sûr plus importante que l’image rêvée chez la
plupart de nos voyageurs, mais quelques-uns d’entre eux, écrivains
ou peintres ne sont pas trop éloignés de Lawrence Durrell, Dino
Buzzati ou Julien Gracq ; et chez tous, c’est la subjectivité
du regard qu’il sera intéressant de mettre en valeur.
Il n’est pas simple d’en débattre ; Giono a écrit : « Il n’y a pas de Provence : qui l’aime, aime le monde ou n’aime rien. » Mais son quasi contemporain Louis Besson 1908-1954, au début d’un gros ouvrage sur Grasse au temps du Conventionnel Maximin Honoré Isnard, affirme : « La Provence est un pays que l’étranger comprend mal. » Les multiples faciès de cette province sont parfois réduits à une simple dualité ; en 1894, sept ans après la publication de La Côte d’Azur du Bourguignon Liégeard, G. Bruno, auteur de ces livres de lecture destinés aux élèves de l’école primaire et assurant bien leur fonction de moyen de documentation, souligne dans le Tour de France de deux enfants, l’ambivalence de notre région : « Quelle superbe contrée , disait le patron Jérôme, que cette Provence toute couverte d’oliviers, de pins et d’herbes odorantes ! C’est mon pays, ajoute-t-il fièrement, et vois-tu, petit, à mon avis, c’est le plus beau du monde. » Mais le narrateur a déclaré auparavant : « Au-delà de l’antique cité d’Arles, la Provence jusque-là couverte de cultures et où on apercevait le feuillage gris des oliviers, devint stérile, sans herbe et sans arbres. Les enfants étaient entrés dans les plaines de la Crau, puis de la Camargue (...) qui ressemblent à un désert de l’Afrique transporté dans notre France. »
En fait, la variété des paysages provençaux est encore plus grande ; elle explique l’abondance et la diversité des communications qui nous sont proposées. Vingt-six conférences seront entendues durant ces deux jours : quatre professeurs allemands, Madame le Doyen du Trinity Collège de Dublin, neuf professeurs de l’Enseignement Supérieur français représentant les Universités d’Aix, Grenoble, Paris, Lille et Nice, cinq érudits dont un élu et un architecte, six conservateurs de musée et bibliothèque, la cohorte fidèle des gardiens de la culture provençale. Mais - est-ce d’ailleurs un fait du hasard ? - les récits en langue allemande sont très nombreux ; ils ont été le terrain d’étude non seulement des professeurs allemands mais aussi de leurs collègues français, ce qui nous a conduits à faire de la première journée celle des écrivains de langue allemande ; le Professeur Alain Ruiz, véritable promoteur de cette réunion en sera certainement tout heureux ; et pour faire bonne mesure, nous avons demandé à Monsieur le Conservateur du Musée Matisse de Nice de nous restituer les images de cette grande migration.
La seconde journée nous révèle les aveux des découvreurs
de langue française ; le fonds de récits de voyage examinés
a une longue dimension chronologique : du milieu du XVIe siècle à
la première guerre mondiale ; il a aussi une largeur typologique exceptionnelle
: du poème en hexamètres latins chers à Monsieur le Professeur
Onimus, au carnet de notes, du récit classique aux règlements
institutionnels, du guide de voyage à l’album de croquis, du tableau
de chevalet aux façades des villes d’agrément. Il sera
présenté huit textes inédits ; sept conférences
sont accompagnées de projections.
Ainsi, espérons-le, quelques réponses seront apportées
aux interrogations sur l’identité provençale : celles portant
sur le paysage perçu par les voyageurs étrangers ; mais comme
le paysage n’est plus, et depuis longtemps qu’une construction de
l’environnement par et pour les hommes, celles portant sur ces bâtisseurs.
Paul Gonnet